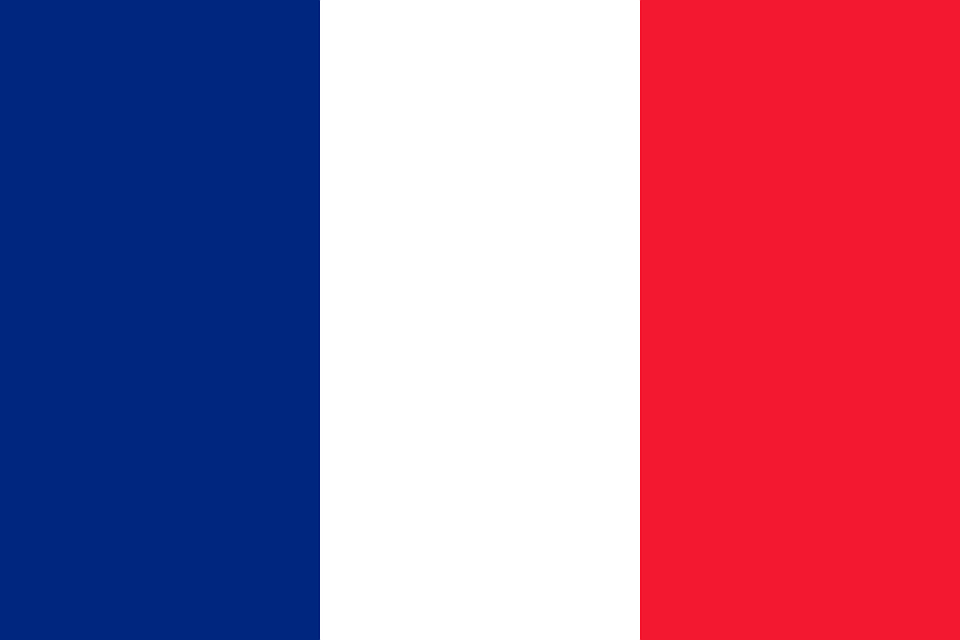Elle est revenue
Elle.
Elle est revenue.
Elle me prend à la gorge, pourtant je la croyais enterrée au fond de mon âme. Elle se manifeste à moi sous la forme bigarrée d’une foule bruyante et tumultueuse. Je ne reconnais plus les sympathiques supporters de l’O.M. .
Cette masse difforme de spectateurs s’avance. L’effroi me remplit le cœur. Mes membres vibrent à en faire trembler toute ma carcasse. Je transpire. Mes mains deviennent moites, mon cœur s’assèche. La nuée de fans progresse, elle va me submerger.
J’accompagnais mon fils au stade pour Marseille/Lyon, cela devait être une fête, mais la foule a tout perturbé. Pierre ne me reconnaît plus. A ses yeux, je dois avoir l’air d’une loque, d’un zombi. Ma gorge joue au yo-yo avec la glotte, alors que je n’existe plus : elle me hante. Adieu le stade, adieu le match, je suis ailleurs ; dans ce lieu maudit où elle m’est apparue pour la première fois. Mon enfant crie en vain, pour me faire revenir dans notre monde paisible ; il n’y peut rien : elle est plus forte.
Elle est revenue.
Son emprise sur moi fait resurgir, sur l’écran blanc de mon passé, des images insupportables.
Je me trouvais au volant de ma petite 4L. Joe Bustagua, mon aide-comptable, me suivait dans sa 4 Chevaux Renault. Je l’apercevais dans mon rétroviseur, il semblait siffloter. Sur son tacot, il avait depuis peu installé à grands frais une radio et la faisait chanter à tue-tête. Joe aimait le rock, le swing, le mouvement. Je le revois imiter Elvis, chantant King Créole.
Le 1er juillet 1962, l’Algérie venait de recouvrer son indépendance. En ce cinq juillet 62, dans les artères d’Oran, des groupes d’individus enthousiastes extériorisaient leur joie. Jamais je n’aurais pu imaginer qu’une telle liesse puisse engendrer un épisode aussi horrible.
Arrivant sur une large avenue, aux voies séparées par un terre-plein arboré, je vis au loin quelques voitures arrêtées en plein milieu de l’artère. Je roulais encore, la 4 Chevaux de Joe me suivait toujours. A hauteur des véhicules, un trio d’hommes armés et en tenue militaire me barra la route. D’autorité, l’un d’entre eux ouvrit la portière et me força à sortir. Je n’eus même pas le temps de réaliser qu’ils m’étaient tous hostiles. Hébété, mon regard se porta sur eux, puis sur les voitures à l’arrêt. Je subissais ces instants plus que je ne les vivais. A quelques mètres, un homme, à la chevelure brune et frisée, de dos, me cachait ce qu’il faisait. Les trois soldats fouillèrent l’automobile, en parlant un arabe dont je ne compris aucun des termes. Ce n’étaient pas des citadins, mais plutôt des fellagas descendus des montagnes. L’indigène, que je n’avais vu que de dos, se retourna. Il tenait un couteau de commando ensanglanté. Mes yeux croisèrent les siens. Comme noyé dans une brume, l’homme me sourit et me fit frissonner malgré la chaleur de juillet. Derrière lui, un corps tomba à ses pieds. Le sang coula, je perdis ma salive. La gorge de la victime avait été tranchée. Le bourreau s’avança vers moi, j’étais le prochain. Des flots de sueur parcoururent entièrement mon corps. Éperdu, mon regard hésitant se porta sur le visage de l’égorgeur, puis sur la chose humaine qui pissait toujours le sang, sur les armes des soldats et enfin sur le couteau du bourreau. Tout cela sembla durer une éternité. Ébranlé, au lieu de penser à moi, je me suis alors retourné pour situer Joe et sa voiture. Pouvait-il agir pour me sortir de là ? Envolés, plus de bagnole, plus de Joe ! Avait-il eu la chance de s’extirper de ce cauchemar ? J’étais seul face au monstre qui se rapprochait. D’une main ferme, il me poussa contre le capot. Avec son arme, il m’obligea à écarter les jambes puis me fouilla. Je maugréais quelques mots dans un délire de sanglots, mais rien d’intelligible. L’homme me retourna et lâcha un :
« Balla’a fummek !* »
La mort était proche. Trop lâche pour l’affronter, je fermai les yeux et je perçus le frottement de l’arme tranchante s’essuyer impudemment sur ma veste. L’humiliation était à son comble. Puis un brouhaha confus, des tirs d’armes, des cris résonnèrent dans ma tête. Le coup fatal ne m’était pas encore porté, qu’attendait mon bourreau ? Mon épaule défaillit sous le poids d’une masse lourde et chaude. Que se passait-il ? Drapeaux, calicots flottant au-dessus d’elle, une foule avançait vers moi, vociférant, beuglant, menaçante. La tête de mon assassin désigné reposait sur mon épaule. Une balle l’avait atteinte et elle saignait abondamment. La troupe de manifestants, enivrée et mue par une passion dévastatrice, progressait rapidement. Abasourdi, comme un boxeur ko debout, je la vis se diriger vers moi.
— Remontez dans la voiture et foutez le camp ! hurla une voix.
J’ai tenté de la localiser, mais je n’ai vu qu’une persienne se refermer.
— Hé, papa ! Tu bouges, on va rater le début du match !
— Je ne peux pas, je ne peux plus !
Je ne sais plus ni à qui ni à quel moment j’ai hurlé ces mots, s’ils étaient adressés à la personne derrière la fenêtre, il y a plus de quinze ans, ou à mon fils à l’instant présent.
— Quoi ? me demande, interloqué, le fiston.
— Je ne peux pas !
— Tu es malade ?
— Non, mais je ne peux pas !
La foule folle de spectateurs avance lentement pour se rendre au stade. Elle est là, face à moi, agitant drapeaux, banderoles, fanions, braillant, gesticulant, effrayante.
— Je ferais mieux de rentrer !
— Rentrer ? s’enquit mon fils.
— Remontez dans la voiture et foutez le camp ! résonnait la voix dans ma tête.
— Oui, c’est ça, je vais rentrer.
Comme un mort-vivant, à pas comptés, alors que la masse de manifestants courait vers moi, je me suis assis dans la voiture. Le moteur tournait toujours, j’ai passé une vitesse et je suis parti. La portière s’est refermée durant mon accélération, comme si elle voulait clore cet atroce moment, gommer ce cauchemar.
Dans un reliquat de conscience, j’espérais que je l’avais plantée là. Pourtant, ce soir encore, la peur m’a prouvé qu’elle est plus forte que je ne le pensais.
Elle est revenue.
* « Ferme ta gueule ! »